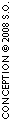Le soleil se lève sur Athènes. Ce jour sera un jour de délivrance pour Socrate, qui patientait au fond de sa prison. Il va être mis à mort. Xanthippe, sa femme, est à ses côtés. Elle pleure. Et Socrate la renvoie.
Pourquoi pleure-t-elle ? Parce qu’elle a de la peine, sans doute. Mais sans doute aussi parce qu’elle cherche à aider l’homme qui doit passer de ce monde-ci vers un ailleurs dont personne n’est jamais revenu, dont personne ne sait même s’il existe — un ailleurs aussi radicalement insondable que celui d’où il est venu, le jour de sa naissance. La femme veille sur ces grands passages (elle est elle-même le passage de la naissance…), dont elle ne sait, pas plus qu’aucun autre, où ils vont, ni d’où ils viennent : elle se fait ainsi pleureuse, accoucheuse (et même accouchante…) Compassion de la femme, qui porte avec chaque voyageur le poids des douleurs et des angoisses de ces sauts inhumains.
Mais Socrate renvoie Xanthippe. Il doit réduire au silence ses incantations pour faire entendre, une dernière fois, et à des hommes, la voix de la raison.
Le voyageur sait pourtant qu’il a besoin d’elle, la gardienne des rituels, l’entremetteuse des autres mondes, la messagère du divin. Il sait aussi que ces autres mondes ne sont que des faces cachées de ce seul monde — du seul, en tout cas, dont il ait jamais eu à se préoccuper. Faces cachées, non par essence, mais pour son regard, aujourd’hui. Lorsque ces autres faces ne lui sont pas visibles, le voyageur en aperçoit parfois quelques ombres — ou quelques signes : ce sont les signes du destin. La nature de ces signes dépend des lieux que le voyageur traverse : les dieux sont immanents, et parlent une multitude de langues régionales. Par ces signes, les dieux obligent le voyageur. En échange de son attention, de son écoute, ils l’aident. À quoi l’obligent-ils ? À toutes sortes de choses : cela dépend des lieux traversés, de ce qu’il est capable d’entendre, de la façon dont il se sent concerné. En quoi l’aident-ils ? En ouvrant devant lui des chemins, lui en montrant les trésors et les dangers secrets. Ce sont les dieux, en effet, qui orientent les projecteurs, découvrant des pans entiers d’espace autour du voyageur. Mais c’est toujours celui-ci qui les a allumés. À tout moment, il peut les éteindre, ou se diriger du côté de l’obscurité. Bientôt, tout sera pareillement éclairé. Plus d’ombres, plus de signes, plus de dieux — rien que la présence immédiate du monde.
Quant aux rituels, il serait réducteur, et superficiel, de chercher à s’en libérer : c’est comme si on voulait se rendre aveugle aux signes que les dieux disséminent ici et là dans le monde. Il faut s’attacher à tous, au contraire, pour être libre des superstitions, des prosélytismes qui y sont si souvent associés. Non pas se libérer de tout rituel, mais se libérer à l’intérieur de chacun d’eux. Bientôt, le voyageur sera passé de l’autre côté des rituels. Plus d’ombres, plus de signes, plus de dieux — rien que l’évidence lumineuse du réel.
Tout cela, Xanthippe le rappelle à Socrate. Et Socrate la renvoie. Il veut encore parler, encore raisonner. Son dernier enseignement, pourtant, sera l’exposé d’un mythe, sa dernière action sera de produire un signe, ses derniers mots seront pour se réconcilier avec le rituel : "N’oublie pas, Criton, le coq que nous avons promis". Sa dernière pensée, nous n’en doutons plus, fut pour Xanthippe, et pour cette dernière main qui lui fut tendue.